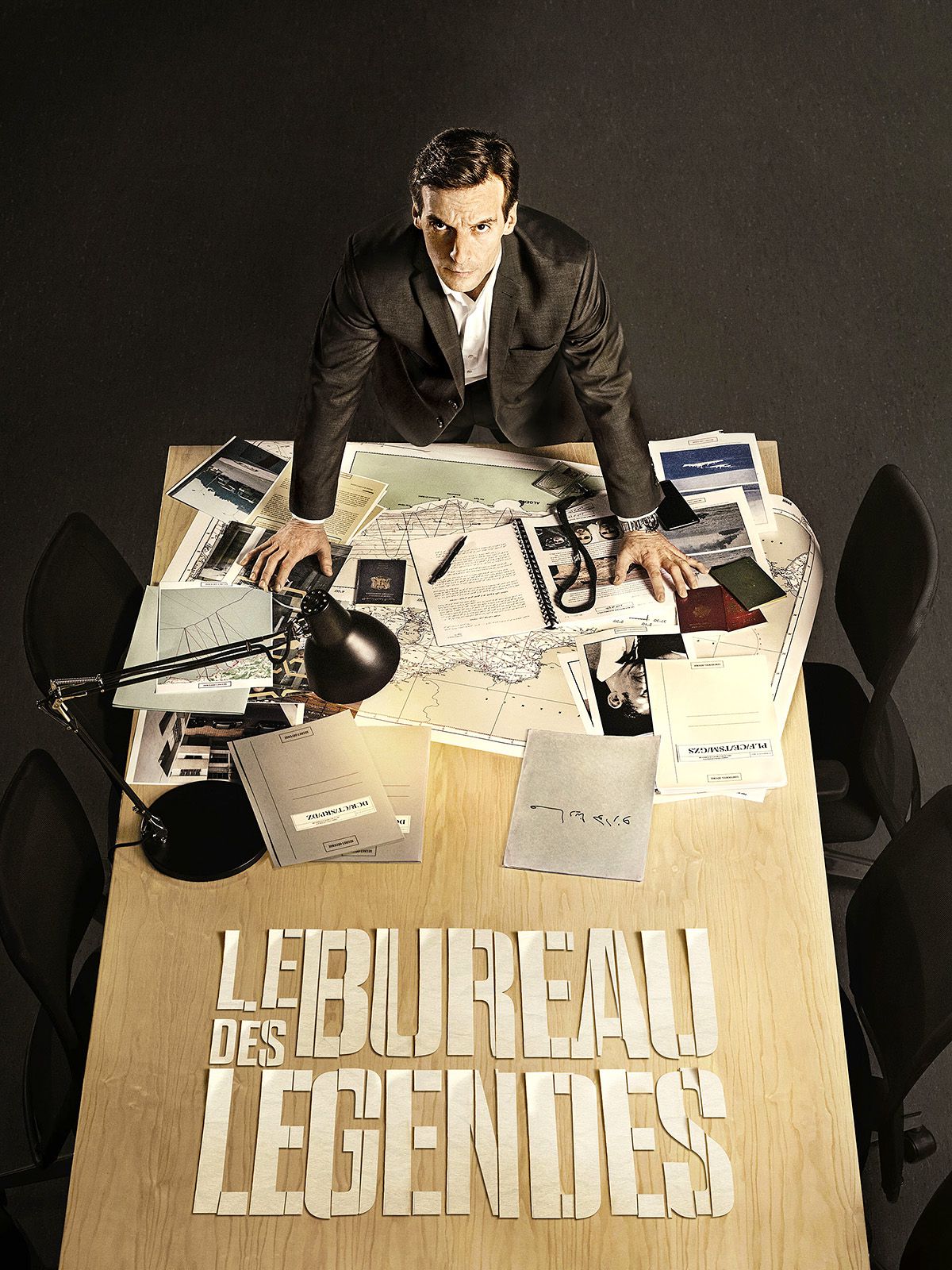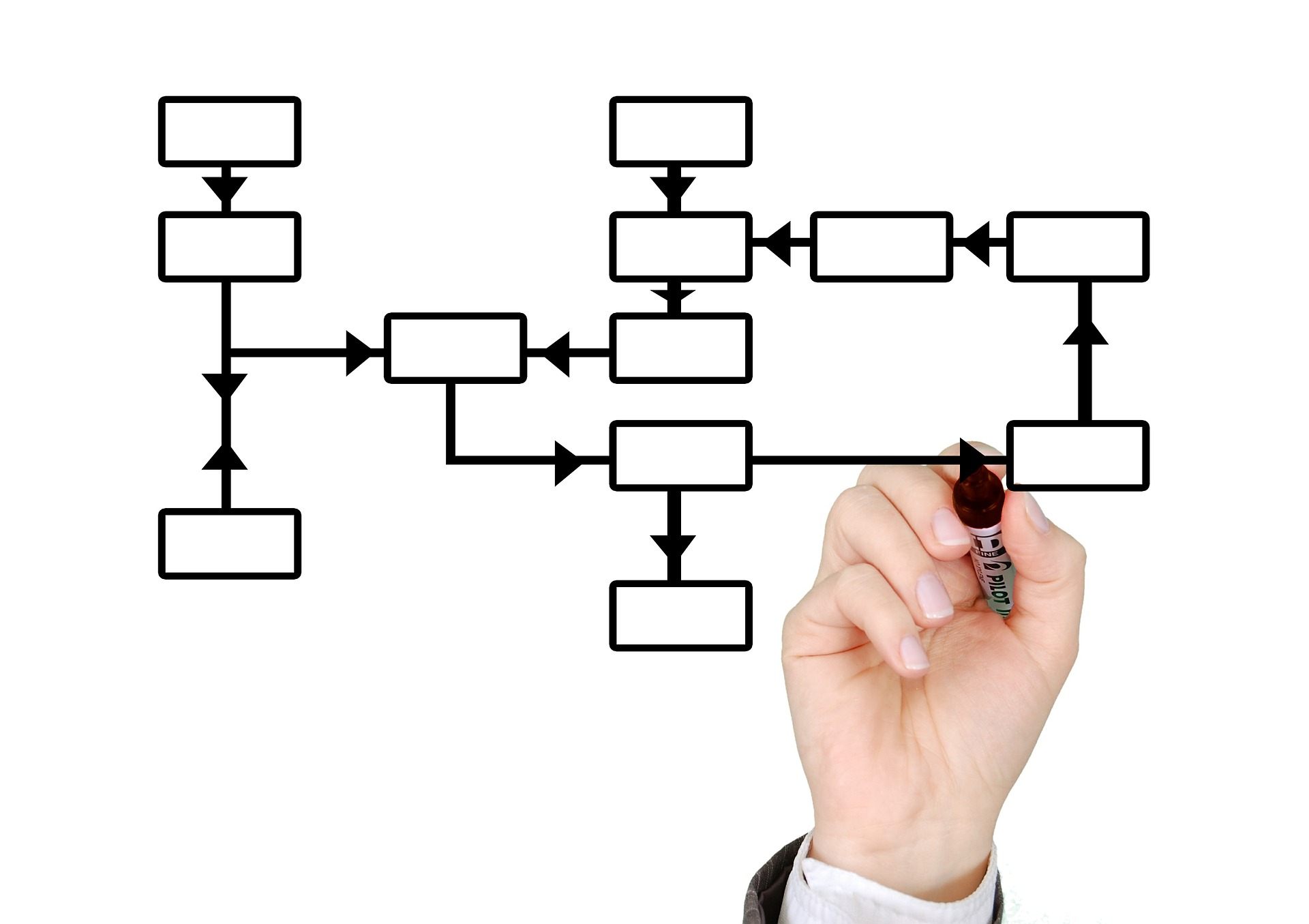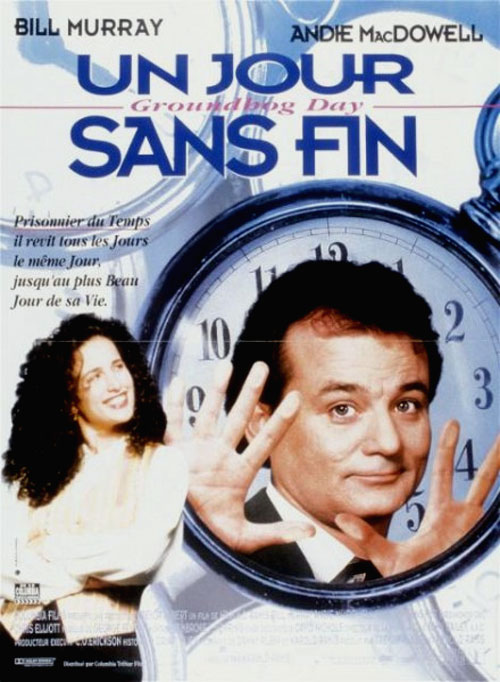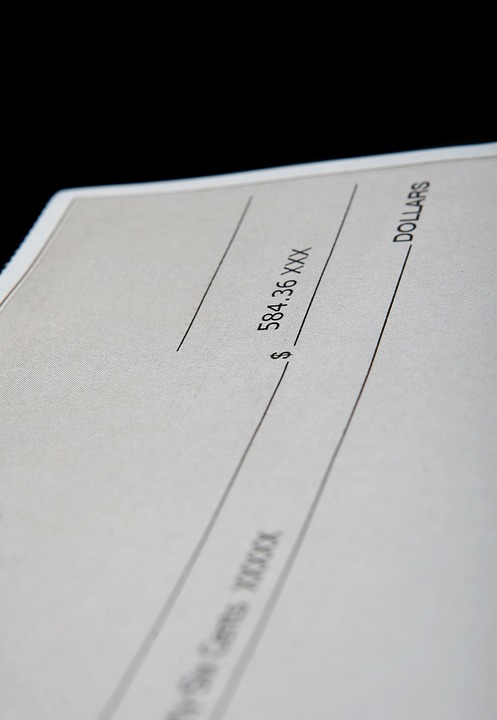Si il y a un mot que l’on ne voit pas beaucoup dans les livres actuels sur le management ou dans les citations qui font florès sur Linkedin et ailleurs, c’est l’AUTORITÉ. C’est devenu une notion péjorative : personne n’en veut et personne n’en parle.
Nous pensons pourtant que l’autorité, bien employée, est non seulement utile, mais indispensable.
L’Autorité, une espèce menacée d’extinction
A l’image des livres qui militent pour l’autonomie voire pour la liberté totale en entreprise, l’autorité est désormais vue comme un défaut, un nuisible. L’autorité renvoie soit aux relations parents-enfants où elle désigne le mode d’éducation d’avant mai 68, soit à l’archétype du petit chef en entreprise qui cache son incompétence par le recours à l’autorité. Deux images peu flatteuses…
On ne compte plus les formations proposées sur le leadership, la valorisation, le management générationnel, le développement de l’autonomie, etc. Sur l’autorité en management, rien ou presque.
Cela montre à quel point la notion d’autorité est confuse, car le problème du petit chef n’est pas d’en avoir mais d’en manquer. L’autorité en management, ce n’est pas l’inverse du participatif mais l’inverse du laxisme ; son principal synonyme, ce serait la fermeté.
Oui mais voilà, la confusion avec l’autoritarisme, l’impression que l’autorité n’est pas une notion très « génération Y », que l’avenir est aux entreprises sans managers, tout cela a fait disparaître l’autorité des radars.
On ne compte plus les formations proposées sur le leadership, la valorisation, le management générationnel, le développement de l’autonomie, etc. Sur l’autorité en management, rien ou presque : deux offres seulement sur internet dont une à Lomé, au Togo. C’est la loi de l’offre et de la demande, l’autorité n’est pas vendeur.
Nous sommes d’ailleurs, nous aussi, pris la main dans le sac : depuis plus de 2 ans que nous écrivons nos avis mensuels, pas une seule fois nous n’avons ne serait-ce que mentionné l’importance de l’autorité en management.
Et pourtant nous le voyons tous les jours dans nos missions où nous côtoyons pourtant des managers courageux et expérimentés, l’autorité est en perdition.
Un ingrédient pourtant indispensable du management
Comprenons bien l’autorité en se référant à la définition qu’en donne le Larousse :
« Crédit, influence, pouvoir dont jouit quelqu’un ou un groupe dans le domaine de la connaissance ou d’une activité quelconque, du fait de sa valeur, de son expérience, de sa position dans la société, etc. ; caractère de quelque chose dont la valeur, le sérieux, communément reconnus, lui permettent de servir de référence »
L’autorité donne de la force de conviction à la vision, pour rallier les plus hésitants de l’équipe en apportant une confiance, une fermeté qui rassure.
Oui, bien sûr, l’autorité seule (c’est à dire sans pédagogie et sans vision principalement) est nocive. C’est ce que l’on appelle l’autoritarisme et c’est ce rapprochement qui joue le rôle d’épouvantail décrit plus haut.
Mais a contrario, la vision sans autorité est également très limitée. L’autorité donne de la force de conviction à la vision, pour rallier les plus hésitants de l’équipe en apportant une confiance, une fermeté qui rassure. Idem pour la pédagogie sans autorité, sa portée est réduite. On ne suit pas quelqu’un parce qu’il vous explique les choses, mais aussi par la force qu’il montre et peut vous transmettre.
A ceux qui opposent liberté et autorité (voire liberté et manager), nous disons qu’ils se trompent gravement. L’autorité crée le cadre dans lequel la liberté se développe, s’anime et se protège. Pour faire vivre les principes de « Liberté Égalité Fraternité », qu’a-t-on créé ? Les Droits de l’Homme et du Citoyen qui vont préfigurer la Loi de la République Française. Liberté et Autorité se nourrissent mutuellement.
Dans le wikimanagement que nous avons mis à disposition de tous, nous parlons de la matrice Boss / Leader / Coach qui résume les 3 postures complémentaires du manager. Le BOSS, à l’image du Parrain que nous prenons comme exemple, représente l’autorité.
L’autorité, ça se développe ?
Une autre idée reçue sur l’autorité, c’est de penser qu’il y a ceux qui l’ont et ceux qui ne l’ont pas. A l’instar de son cousin germain le charisme, ce serait une qualité innée et d’ailleurs inexplicable. Comment expliquer que certains professeurs obtiennent facilement le silence et l’attention des élèves alors que d’autres, apparemment plus durs et plus directifs, n’y arrivent pas ? C’est une alchimie naturelle qui ne se travaille pas, un peu magique, pense-t-on souvent.
C’est FAUX ! L’autorité se travaille et surtout elle s’anime astucieusement (un peu comme la musique où l’on travaille d’un côté le solfège et de l’autre l’instrument), c’est ainsi qu’on la développe.
Pour la travailler, voici quelques éléments non exhaustifs.
- Définir un cadre clair : le manque d’autorité naît souvent d’une confusion sur le cadre, comme un jeu de société ou les règles sont floues et où les joueurs finissent par se lasser du jeu. Il faut préciser simplement et fortement les règles de votre jeu tout en garantissant des degrés de liberté.
- Maîtriser 3 dimensions de l’autorité : à savoir la définition d’objectifs précis, la valorisation et le recadrage. Là-dessus, les méthodes sont innombrables, l’important est de réussir à donner un rôle à chacun, à valoriser les réussites et à recadrer les manquements. C’est simple, mais c’est crucial et pas si facile.
- Faire court : l’autorité consiste finalement à faire les points 1 et 2 de manière dense et concise. Ainsi, vous serez reconnu pour votre efficacité et pour votre capacité à faire gagner du temps à tout le monde. Gagner du temps… le graal en entreprise pour bon nombre d’entre nous.
Sur le sujet, nous ne pouvons que vous renvoyer à l’excellent ouvrage Le manager minute (Ken Blanchard & Spencer Johnson, Eyrolles, 2006) qui est aussi facile à lire qu’il est limpide sur l’exercice de l’autorité.
L’autorité est aussi une question d’animation. Il faut savoir exercer son autorité quand elle ne va pas de soi et inversement. Prenons un exemple : si vous êtes un directeur industriel et que vous vous adressez à un opérateur, cela ne sert à rien d’être autoritaire car votre fonction vous donne, dans le rapport bilatéral, une autorité évidente, le doublon pourrait même porter préjudice et vous donner une image d’autocrate. Mais si vous êtes un jeune manager arrivant dans une équipe expérimentée, l’autorité doit s’exercer pour que votre référence, en tant que manager, s’installe.
L’autorité demande donc une prise de conscience, quelques outils simple et surtout de l’intelligence relationnelle. Bien loin des clichés donc.