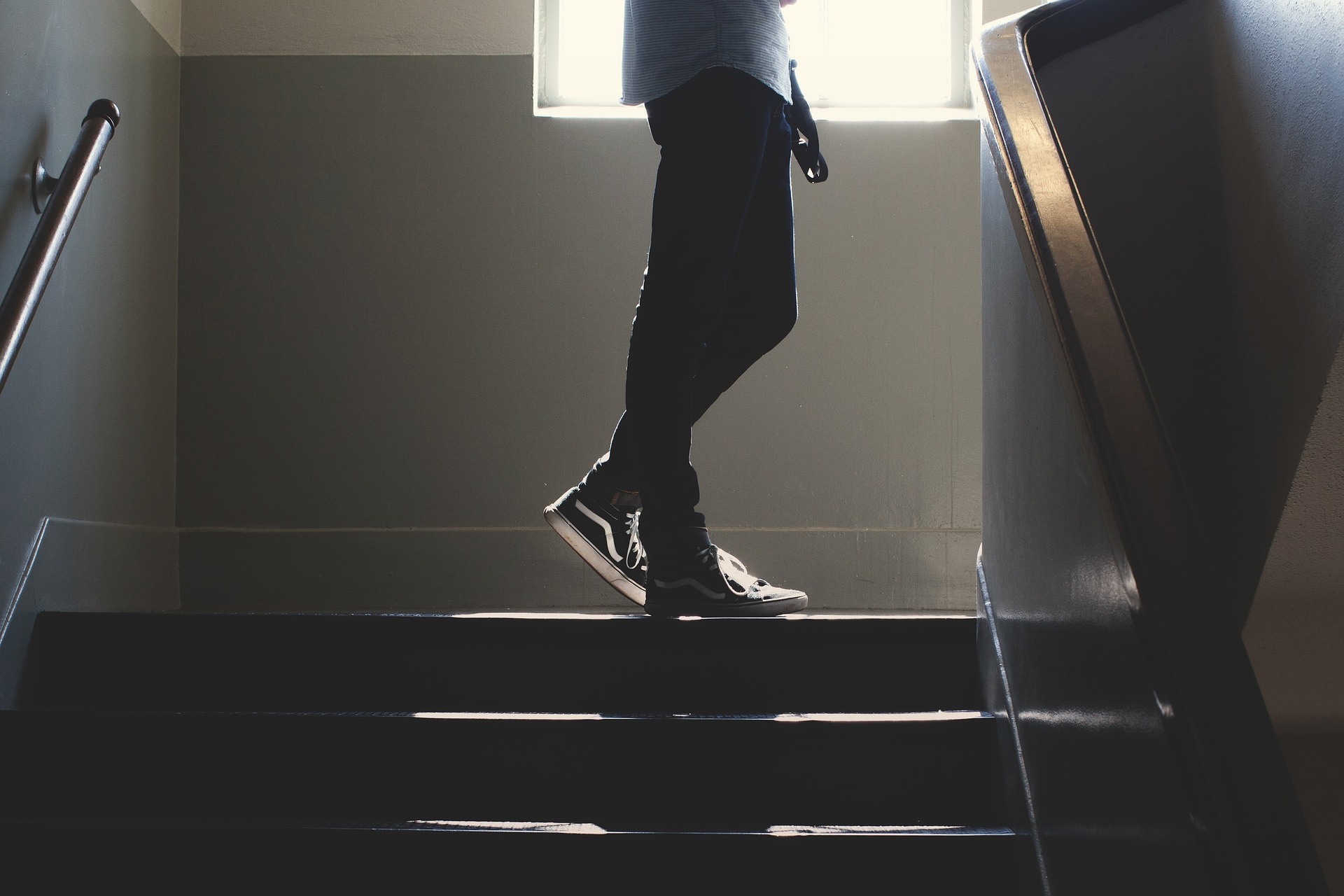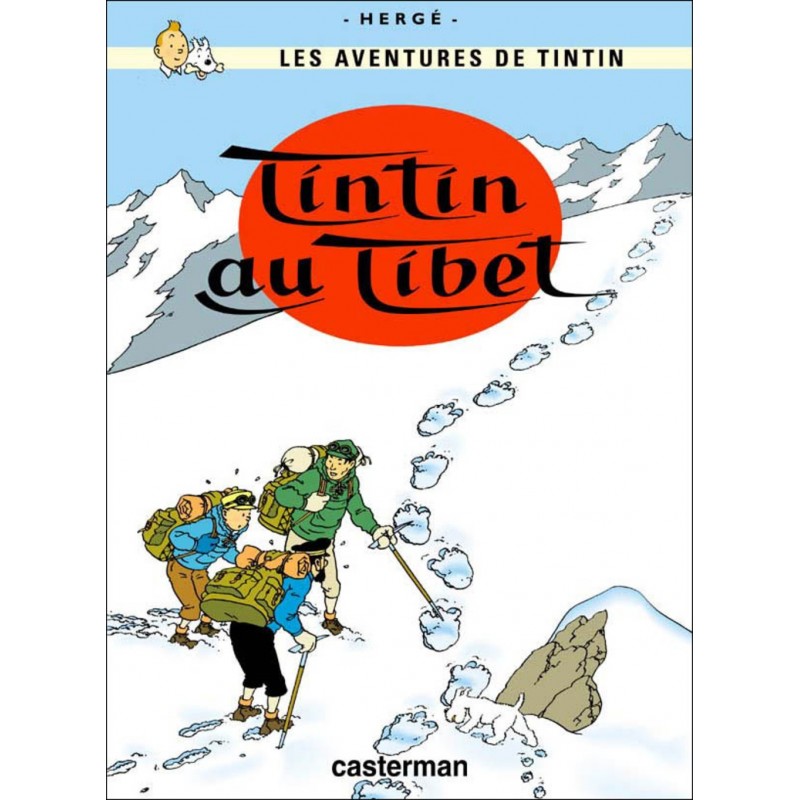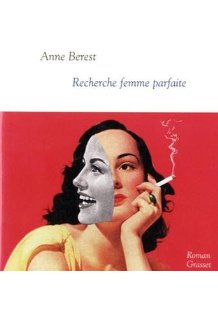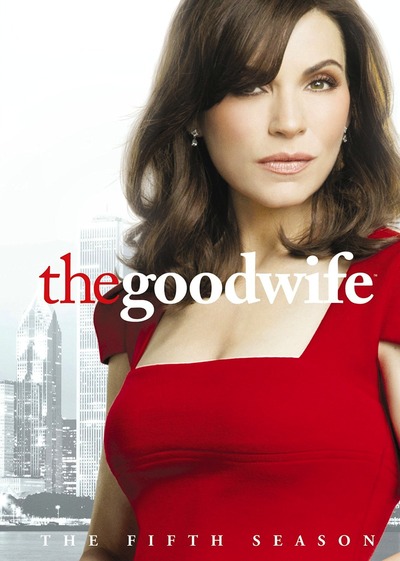La prise de poste est un moment important pour un manager ; c’est un changement pour tout le monde, le manager et les managés. C’est le moment où l’on pose les bases de son management.
Et on a donc tendance à vouloir aller vite. Et bien nous nous pensons qu’au contraire, il faut aller lentement.
On agit vite pour prouver rapidement qu’on est légitime à ce nouveau poste
On voit par exemple souvent des managers qui, à peine arrivés, lancent des réformes : modifier l’organisation, revoir les priorités, imposer de nouvelles règles…
Ou parfois, les managers décident de faire la tournée de leurs équipes avec des messages-clés à faire passer : une orientation, des valeurs, un calendrier, un projet…
Toutes ces actions, tournées ou annonces ont pour vocation de mettre en avant le leadership du nouvel arrivant. Et on les justifie soit parce qu’on a reçu une lettre de mission de son n+1 en ce sens, soit parce qu’on connaît déjà les équipes, soit encore parce qu’on a été nommé avec une situation d’urgence à traiter. Bref toutes les raisons d’agir vite.
Mais c’est une erreur
Une évidence d’abord : aller trop vite dans l’action, c’est ne pas prendre le temps d’écouter les équipes, de s’intéresser à ce qu’elles font bien, à leurs craintes et espoirs.
Conséquence, c’est avoir une vision superficielle de ses équipes (même si vous les connaissez déjà), ne les voir qu’à travers les préjugés des prédécesseurs ou par une première impression forcément trompeuse parce que votre équipe n’est pas 100% elle-même dans un moment où elle ne vous connaît pas.
Cela génère donc 3 gros risques qui peuvent se cumuler :
- Les 1ères mesures sont un peu à côté de la plaque parce qu’elles ne tiennent pas compte d’un détail, d’une action en cours. Elles paraissent donc faites à la va-vite et un peu théoriques. C’est un peu le syndrome Hollande avec des premières lois mal ficelées.
- Les 1ères mesures sont déconnectées les unes des autres et ne s’insèrent pas dans une logique globale. Les équipes les comprennent mal et votre démarrage pied au plancher ressemble à de l’agitation. C’est le démarrage Sarkozy. Trop d’agitation, pas assez de fond et de cohérence.
- Votre démarrage renforce les éventuels clivages dans l’équipe alors qu’une prise de poste est un moment rêvé pour rétablir la confiance.
Ce démarrage rapide est donc le meilleur moyen de perdre du temps parce qu’il vous fait partir vite mais seul et possiblement dans la mauvaise direction.
Objectif lenteur et 0 leadership
Il faut avoir pour seul premier objectif de comprendre. Comprendre ce que les équipes aiment faire, ce dont elles sont fières, ce qui les distingue des autres. Comprendre aussi là où c’est difficile, comment ils l’expliquent, ce que cela génère chez eux comme frustration, comme conséquences. Comprendre comment s’organisent les équipes, pas seulement dans leur métier mais aussi en termes de dynamique entre les personnes.
La prise de poste est un moment qui ouvre des tas de possibilités si on prend le temps de les construire.
Ça paraît évident, mais cela veut dire un tour de l’équipe sans opinion ni sur les équipes ni sur ce que l’on va faire avec elles.
Bien sûr, on ne veut pas caresser les équipes dans le sens du poil. Mais pour avoir la possibilité de remettre en cause l’existant, il faudra être précis, factuel, juste. Bref, être lent, c’est être tactique :
- C’est d’abord pour préserver et amplifier les points forts.
- C’est pour changer des choses en faisant cas de ce qui a déjà été fait. Rien de plus insupportable qu’une mesure qu’on annule de façon dogmatique sans en préserver les aspects positifs : regardez Trump avec l’Obamacare !
- C’est aussi pour utiliser les bons mots. Ne négligez pas cette dimension émotionnelle. Les équipes sont comme une bande de copains avec leurs expressions et private jokes… Les ignorer c’est rester en dehors de la bande.
- C’est aussi pour s’appuyer sur VOS alliés dans les 1ères mesures. Souvent, on se borne aux alliés connus du système, et on ne va pas chercher de nouvelles énergies… C’est dommage ; c’est bien plus facile à ce moment là.
La prise de poste est un moment qui ouvre des tas de possibilités si on prend le temps de les construire. Evidemment le temps de la lenteur est relatif : les fameux « 100 jours » pour un manager de terrain ce n’est pas tenable ; dans une équipe de 10 personnes prévoyez 2 semaines. Mais 100% écoute.
Même dans les cas où la vitesse semble une évidence
Si on connaît déjà très bien l’équipe :
C’est évidemment un avantage et on peut bien sûr accélérer un peu. Mais attention, vous avez changé de position et les attitudes vis-à-vis de vous vont nécessairement changer. Et puis, vous avez changé de poste, ce n’est pas pour faire la même chose.
Dans une situation d’urgence :
Réflexe (de pompier), aller au feu. Mais vous n’êtes pas un surhomme donc vous ne changerez pas la situation en un claquement de doigts. Prenez le temps de comprendre les causes de la crise, et donnez-vous la possibilité de l’aborder différemment, pour vous attaquer aux causes racines.
Quand tout va bien :
Là au contraire, ne prenez pas le risque de casser la belle machine en la touchant trop vite et sans habileté. Cherchez à comprendre les raisons de sa performance, pour les développer et vous attaquer aux nouveaux enjeux ; pour préparer le long terme.
La prise de poste est un moment court, mais précieux ; à ce moment, vous n’avez fait encore aucune erreur et vous vous préparez pour 3 à 6 ans à la tête de cette équipe. Osez perdre 2 semaines à 1 mois pour être le plus ajusté possible ; oubliez le leadership, vous en ferez plus tard. Le meilleur démarrage n’est pas fulgurant, il est stratège. Pensez tortue, pas lièvre !